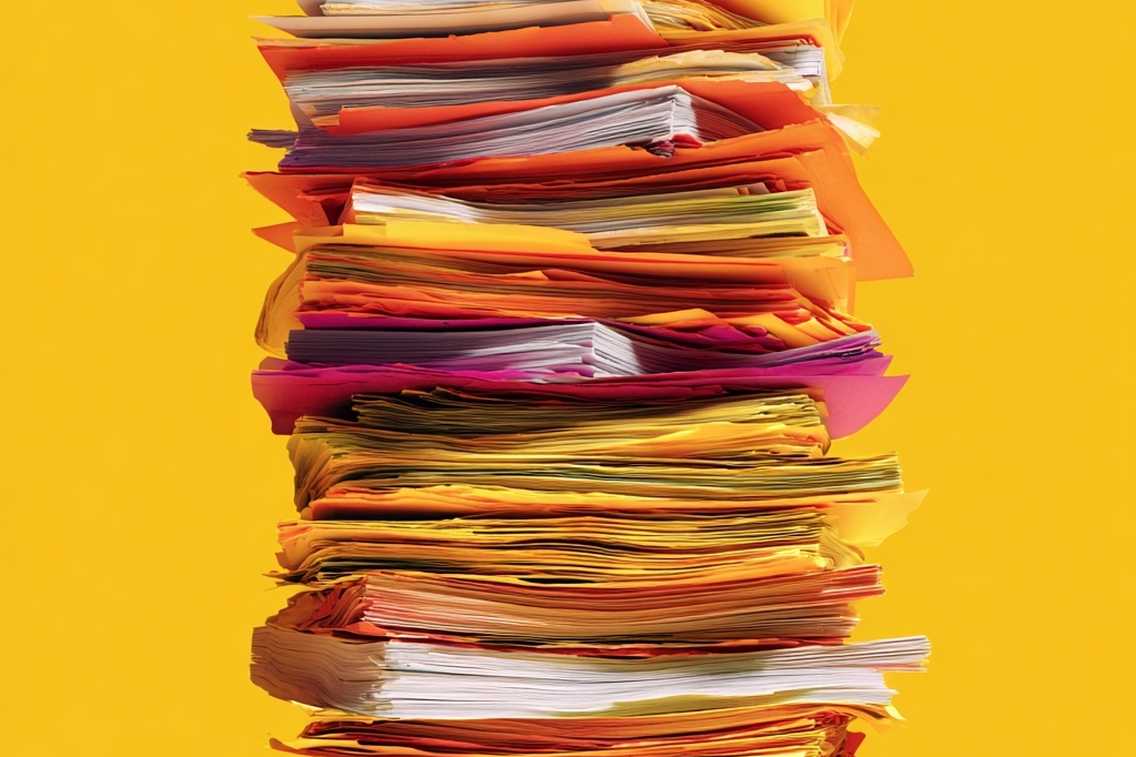1. En résumé
- ➜ Les entreprises restent soumises à l’impôt sur les bénéfices, avec des taux modulés selon leur taille et leur statut juridique.
- ➜ La TVA conserve ses différents niveaux d’imposition selon la nature des biens ou services, sans changement majeur cette année.
- ➜ Les taxes locales, comme la CFE et la CVAE, demeurent en vigueur malgré les reports de réforme.
- ➜ L’emploi de salariés entraîne le paiement de multiples cotisations sociales et contributions obligatoires.
- ➜ De nouvelles contributions exceptionnelles concernent les grandes entreprises et certaines opérations financières.
2. Les impôts sur les bénéfices
Impôt sur les sociétés (IS)
L’impôt sur les sociétés (IS) demeure fixé à un taux normal de 25 % en 2025.
Les petites et moyennes entreprises peuvent bénéficier d’un taux réduit de 15 % sur leurs premiers 42 500 euros de bénéfices, à condition de réaliser un chiffre d’affaires inférieur à 10 millions d’euros, d’avoir un capital entièrement libéré et d’être détenues à au moins 75 % par des personnes physiques ou des sociétés elles-mêmes éligibles.
Les grandes entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse un milliard d’euros sont soumises à une contribution exceptionnelle sur les bénéfices instaurée par la loi de finances 2025.
Impôt sur le revenu (IR)
Les entreprises individuelles, micro-entreprises et sociétés de personnes ne sont pas soumises à l’IS mais à l’impôt sur le revenu (IR).
Dans ce cas, les bénéfices sont intégrés dans le revenu imposable du dirigeant et taxés selon sa tranche marginale, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) ou des bénéfices agricoles (BA), selon la nature de l’activité exercée.
3. Les impôts sur le chiffre d’affaires
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) reste au cœur du système fiscal français. En 2025, le taux normal demeure fixé à 20 %, applicable à la majorité des ventes de biens et de prestations de services.
Le taux intermédiaire de 10 % s’applique notamment à la restauration, aux travaux d’entretien dans les logements ou aux transports de voyageurs.
Le taux réduit de 5,5 % concerne les produits alimentaires, les livres, les abonnements de gaz et d’électricité ainsi que les équipements favorisant la transition énergétique.
Enfin, un taux super-réduit de 2,1 % est réservé à des produits ou services très spécifiques comme la presse ou les médicaments remboursables.
Les petites entreprises peuvent, sous certaines conditions, être exonérées de TVA grâce au régime de la franchise en base.
Le projet de réforme de 2025 visant à instaurer un seuil unique de franchise à 25 000 euros a été suspendu. Les seuils antérieurs demeurent donc provisoirement en vigueur, dans l’attente d’une future harmonisation.
4. Les impôts et taxes locales
Contribution Économique Territoriale
Les entreprises exerçant une activité en France sont soumises à la Contribution Économique Territoriale (CET), qui regroupe deux impôts distincts : la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) et la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE).
La CFE concerne toutes les structures exerçant une activité professionnelle non salariée, qu’elle soit commerciale, artisanale ou libérale. Elle est calculée à partir de la valeur locative des biens immobiliers utilisés pour l’activité, qu’ils soient détenus ou loués.
La CVAE, quant à elle, n’est pas supprimée en 2025 : sa suppression est reportée à 2030, avec maintien des taux actuels et création d’une contribution complémentaire pour neutraliser la baisse anticipée.
Par ailleurs, la CET reste plafonnée à 1,438 % de la valeur ajoutée produite par l’entreprise.
Taxe foncière et TEOM
Les entreprises propriétaires de leurs locaux doivent s’acquitter de la taxe foncière, calculée sur la base de la valeur locative cadastrale et des taux votés par les collectivités locales.
Les sociétés locataires supportent indirectement cette taxe à travers leurs loyers, puisque la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), qui finance la collecte et le traitement des déchets, est souvent refacturée par le propriétaire.
5. Les taxes liées à la masse salariale
Employer du personnel en France entraîne le paiement d’un ensemble de charges sociales.
Les cotisations patronales, qui financent la Sécurité sociale, les retraites, la formation professionnelle, l’assurance chômage et la prévoyance, représentent en moyenne entre 40 % et 45 % du salaire brut, selon la taille et l’activité de l’entreprise.
Les entreprises de plus de 11 salariés situées dans une zone où cette contribution a été instaurée doivent également verser le « versement mobilité », destiné à financer les transports publics locaux. Son taux est fixé par les autorités régionales et peut varier selon la zone géographique.
La formation professionnelle et l’apprentissage sont soutenus par deux contributions principales : la contribution à la formation professionnelle, égale à 0,55 % de la masse salariale pour les entreprises de moins de 11 salariés et à 1 % pour celles qui dépassent ce seuil ; et la taxe d’apprentissage, fixée à 0,68 % (0,44 % en Alsace-Moselle).
Les entreprises de plus de 50 salariés sont en outre tenues de verser la participation à l’effort de construction (PEEC), communément appelée « 1 % logement », équivalente à 0,45 % de la masse salariale.
Enfin, les sociétés non assujetties à la TVA, telles que certaines associations ou professions libérales, sont redevables de la taxe sur les salaires, calculée selon un barème progressif allant de 4,25 % à 13,6 % selon le niveau de rémunération.
6. Les taxes sectorielles et spécifiques
Certaines taxes ne concernent que des secteurs ou des situations particulières. La taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) a été supprimée en 2023 et remplacée par deux contributions environnementales annuelles : l’une basée sur les émissions de CO₂ et l’autre sur l’ancienneté et les polluants des véhicules utilisés à des fins professionnelles. Cette mesure vise à encourager le renouvellement des flottes vers des modèles plus écologiques.
En Île-de-France, les entreprises peuvent être soumises à la taxe sur les bureaux, entrepôts et surfaces commerciales, calculée selon la localisation, la superficie et l’usage des locaux. Les sociétés dont le chiffre d’affaires hors taxes dépasse 19 millions d’euros doivent s’acquitter de la Contribution Sociale de Solidarité des Sociétés (C3S), fixée à 0,16 % du chiffre d’affaires et collectée par l’URSSAF.
À cela s’ajoutent différentes redevances environnementales, dont la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP), applicable aux entreprises dont l’activité génère des déchets ou des nuisances, ainsi que les contributions liées à la Responsabilité Élargie du Producteur (REP), pour le recyclage des emballages, équipements électriques ou produits chimiques.
7. Les contributions exceptionnelles (2025)
Contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises
Cette contribution s’applique aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés dont le chiffre d’affaires excède 1 milliard d’euros. Elle est calculée sur la moyenne des bénéfices imposables des exercices 2024 et 2025, avant imputation des déficits antérieurs.Le taux exact varie selon la taille de l’entreprise :
- ● Taux standard pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 1 et 3 milliards € : 20,6 % du bénéfice imposable.
- ● Taux majoré pour les entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse 3 milliards € : 41,2 % du bénéfice imposable.
Cette contribution est non déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés et n’est pas reconductible au-delà de l’exercice 2025, sauf décision contraire du législateur. Elle vise notamment les grands groupes industriels, énergétiques et financiers réalisant des marges exceptionnelles.
Exemple : une société réalisant 2,2 milliards € de chiffre d’affaires et 400 millions € de bénéfice imposable moyen sur 2024-2025 paiera : 400 M € × 20,6 % = 82,4 millions d'euros de contribution exceptionnelle.
Taxe sur les rachats d’actions (réductions de capital)
Depuis le 1ᵉʳ janvier 2025, une taxe de 8 % s’applique aux réductions de capital par annulation de titres résultant de rachats d’actions effectués par la société émettrice. Elle vise les entreprises établies en France dont le chiffre d’affaires dépasse 1 milliard d’euros, qu’elles soient cotées ou non.
Les opérations exonérées sont notamment :
- ● les rachats réalisés dans le cadre d’un plan d’actionnariat salarié ;
- ● les rachats destinés à soutenir la liquidité du titre (opérations de marché réglementées) ;
- ● les restructurations intra-groupe ne modifiant pas le capital économique.
L’objectif affiché du dispositif est de dissuader les programmes de rachat massifs visant à soutenir artificiellement le cours des actions, et d’inciter les entreprises à privilégier l’investissement ou la redistribution salariale.
Exemple : une entreprise cotée rachetant 100 millions € d’actions pour les annuler devra verser une taxe de 8 millions d'euros.
8. Les impôts à la création ou à la fermeture d’entreprise
Lors de la création, de la transmission ou de la cessation d’activité, certaines taxes s’appliquent ponctuellement.
Les droits d’enregistrement sont dus lors de la constitution d’une société, de la cession de parts sociales ou de la vente d’un fonds de commerce. Leur taux varie généralement entre 0,1 % et 5 % selon la nature et le montant de l’acte.
En cas d’acquisition d’un bien immobilier, l’entreprise doit s’acquitter des droits de mutation, composés d’un droit départemental, d’une taxe communale et d’un prélèvement au profit de l’État, représentant en moyenne environ 5 % du prix d’achat.
9. Les exonérations et allègements possibles
Malgré une fiscalité dense, plusieurs dispositifs permettent de réduire la pression fiscale :
- ● Les entreprises implantées en Zone Franche Urbaine – Territoire Entrepreneur (ZFU-TE) peuvent bénéficier, sous conditions, d’exonérations temporaires de Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) et d’impôt sur les sociétés jusqu’au 31 décembre 2025.
- ● Dans les territoires ruraux, le dispositif France ruralités revitalisation (FRR), héritier des anciennes ZRR, accorde également des exonérations d’impôt et de CFE jusqu’en 2027.
- ● Le statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI) offre, lui aussi, des avantages fiscaux et sociaux aux sociétés réalisant des dépenses de recherche et développement.
- ● Enfin, les crédits d’impôt - notamment le Crédit d’Impôt Recherche (CIR) et le Crédit d’Impôt Innovation (CII) - demeurent des leviers puissants pour financer la R&D, même si leurs taux ont été ajustés à la baisse pour recentrer l’aide publique sur les projets à forte valeur scientifique.
10. Tableau récapitulatif
| Catégorie |
Principales taxes |
Points clés 2025 |
| Bénéfices | IS, IR | IS 25 % ; taux PME 15 % jusqu’à 42 500 € (CA ≤ 10 M€, capital libéré, détention ≥ 75 %) |
| Chiffre d’affaires | TVA | 20 % / 10 % / 5,5 % / 2,1 % ; franchise 25 k€ suspendue |
| Locales | CFE, CVAE, taxe foncière, TSB (IDF) | CVAE maintenue (suppression reportée 2030), plafond CET : 1,438 % VA |
| Masse salariale | Cotisations, formation, PEEC, taxe sur salaires, mobilité | Formation 0,55 % / 1 % ; PEEC 0,45 % ; mobilité selon zone |
| Sectorielles | C3S, TGAP, REP | C3S 0,16 % ; TGAP renforcée ; REP étendue |
| Exceptionnelles | Contribution bénéfices, taxe rachats d’actions | Contribution grandes entreprises + taxe 8 % sur annulations de titres |
| Exonérations | JEI, ZFU-TE, FRR | Exonérations prolongées jusqu’à 2025–2027 |