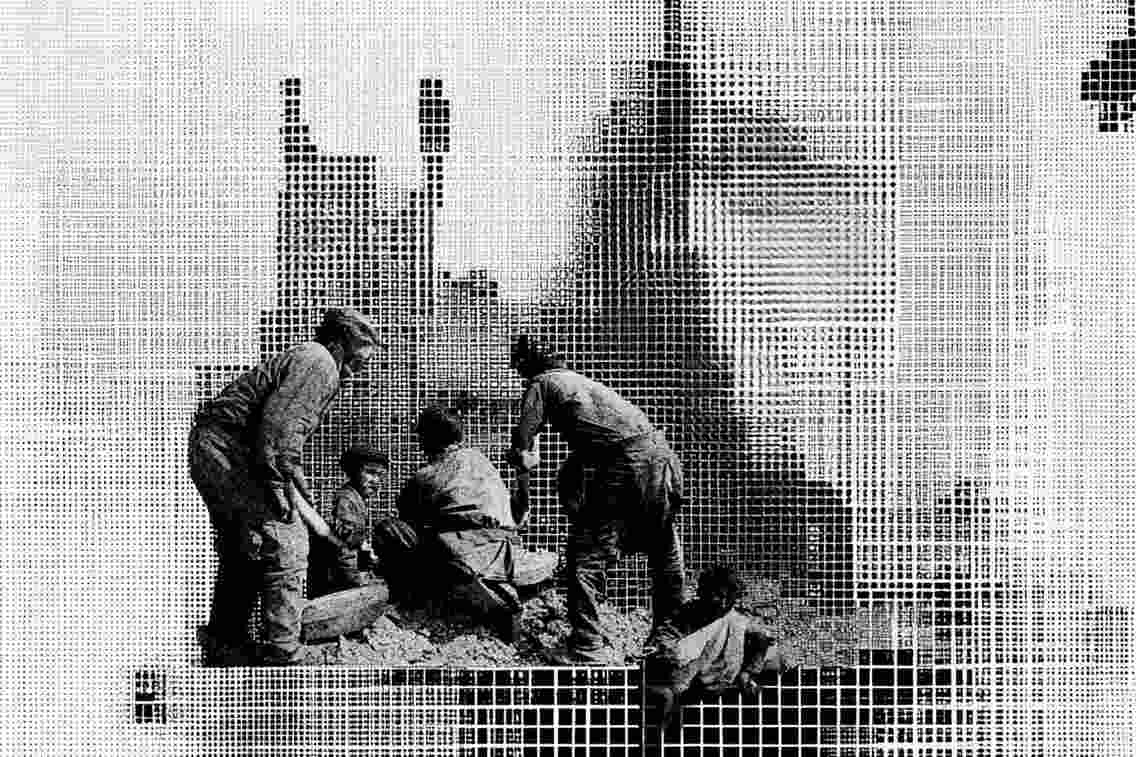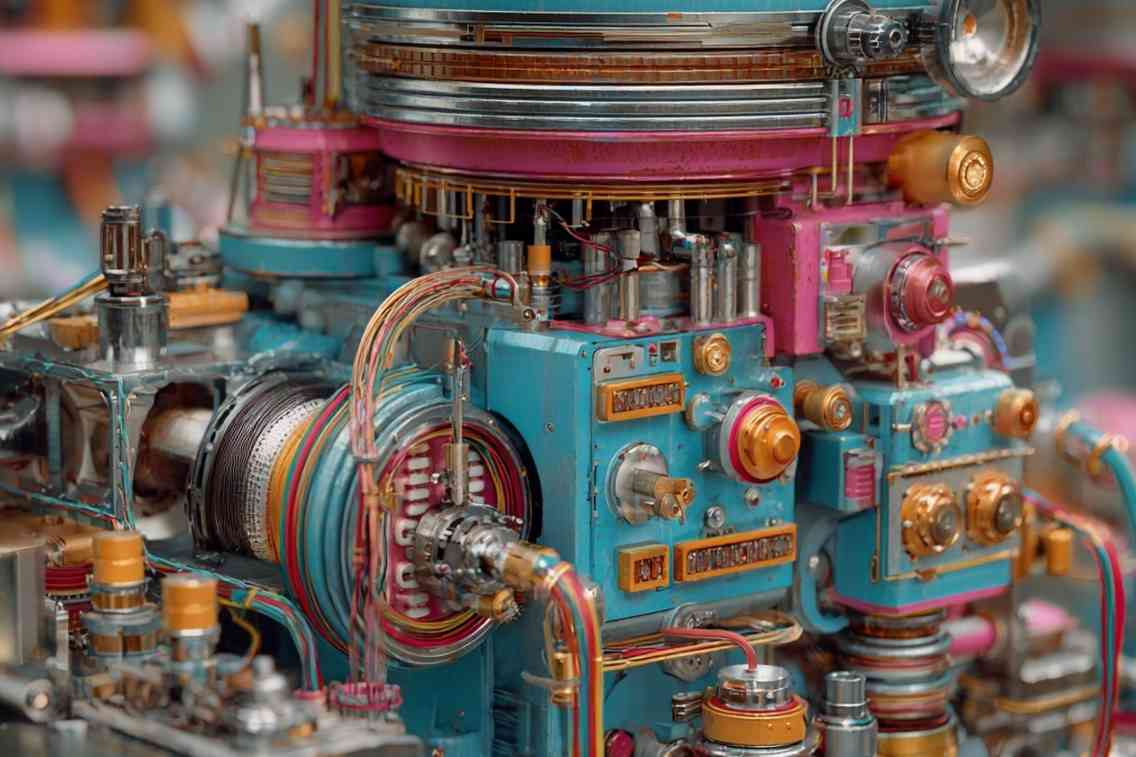1. En résumé
- ➜ La garantie décennale s’applique lorsque des travaux créent ou modifient un ouvrage de manière significative et qu’un défaut pourrait affecter sa solidité ou son usage normal, selon les critères du Code civil et de la loi Spinetta.
- ➜ Sont classiquement décennaux : le gros œuvre, les travaux d’étanchéité/couverture, ainsi que les équipements indissociables intégrés au bâti dont la défaillance peut rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
- ➜ Le second œuvre n’est pas automatiquement décennal : il le devient uniquement si un désordre grave empêche l’usage normal du bâtiment, par exemple humidité généralisée, infiltrations ou insalubrité.
- ➜ Sont exclus de la décennale les travaux d’entretien, de maintenance légère et les interventions purement décoratives, qui n’affectent ni la structure ni l’usage du bâtiment.
- ➜ Depuis l’arrêt du 21 mars 2024, les équipements ajoutés ou remplacés sur un ouvrage existant ne relèvent plus de la décennale s’ils ne constituent pas eux-mêmes un ouvrage, même en cas de désordre grave : ils relèvent alors de la responsabilité contractuelle de droit commun.
2. La règle clé pour savoir si un travail a besoin d’être couverte par une assurance décennale
Pour déterminer si des travaux doivent être couverts par une assurance décennale, vous pouvez partir d’un critère central, posé par le Code civil et structuré par la loi Spinetta : la décennale s’applique lorsque vous réalisez un travail qui crée un ouvrage de construction ou qui modifie un ouvrage existant de façon suffisamment importante, et que cet ouvrage peut, en cas de malfaçon, mettre en cause la solidité du bâtiment ou son usage normal.
👉 Autrement dit, la question n’est pas « quel métier intervient ? » mais « quel impact le travail a-t-il sur l’ouvrage ? ». La loi Spinetta de 1978 a justement instauré ce régime de responsabilité de plein droit pour sécuriser ces risques majeurs, ensuite précisés par les articles 1792 et suivants.
L’idée d’« ouvrage » est volontairement large. Elle vise évidemment les constructions neuves, mais aussi les transformations lourdes sur existant. Dès que ce que vous faites participe à la structure, au clos ou au couvert, ou encore à l’étanchéité générale du bâtiment, la jurisprudence considère qu’on est dans le périmètre décennal parce qu’un défaut aurait des conséquences graves et durables. C’est pourquoi des travaux de rénovation peuvent être décennaux même s’ils interviennent dans un bâtiment ancien, si leur rôle est comparable à celui d’une construction neuve sur le plan technique ou fonctionnel.
Un autre repère très utile est la distinction entre équipements « indissociables » et « dissociables ».
- ● Les éléments indissociables, ceux que vous ne pouvez pas enlever sans détériorer le gros œuvre, sont assimilés à l’ouvrage et relèvent de la décennale.
- ● Les équipements dissociables relèvent en principe de la biennale. Ils peuvent toutefois relever de la décennale lorsqu’un dysfonctionnement rend l’ouvrage impropre à sa destination, sauf dans le cas, clarifié depuis l’arrêt du 21 mars 2024, des équipements ajoutés sur existant qui ne constituent pas eux-mêmes un ouvrage.
3. Les travaux de gros œuvre
Dès que vous intervenez sur le « squelette » d’un bâtiment, vous êtes dans le champ de la garantie décennale. Le gros œuvre correspond à tout ce qui assure la stabilité, la tenue mécanique et la pérennité de la construction. C’est la partie sans laquelle le bâtiment ne tient pas debout ou ne reste pas sain dans le temps. À ce titre, la jurisprudence et les guides juridiques sont constants : ces travaux relèvent en principe de la responsabilité décennale, parce qu’une malfaçon peut affecter directement la solidité de l’ouvrage.
Concrètement, sont toujours considérés comme décennaux les travaux portant sur les fondations et l’assise du bâtiment, qu’il s’agisse de semelles, longrines, pieux ou radiers. Si ces éléments sont défectueux, vous pouvez provoquer un affaissement ou des fissures structurelles, donc un risque typique de décennale. Les murs porteurs, les dalles, les planchers, les poutres et poteaux sont dans la même logique : ce sont des éléments porteurs indispensables à la stabilité. Une faiblesse, un mauvais ferraillage, un défaut de mise en œuvre ou une mauvaise reprise de charges peuvent rendre le bâtiment dangereux ou inutilisable, ce qui déclenche la décennale.
La charpente entre également en principe dans ce périmètre, qu’elle soit traditionnelle ou industrielle. Parce qu’elle participe à la structure et au maintien de la toiture, un défaut de charpente peut entraîner des déformations, des infiltrations majeures, voire un risque d’effondrement. C’est pour cela que, dès que vous concevez, posez ou remplacez une charpente, votre intervention est décennale.
La décennale ne concerne pas seulement le neuf. Vous êtes tout autant dans la décennale quand vous modifiez le gros œuvre d’un bâtiment existant. Si vous réalisez une ouverture dans un mur porteur, vous touchez directement à la structure et au cheminement des charges. Une erreur peut créer des fissurations, des affaissements progressifs ou une instabilité générale. Même logique pour une reprise en sous-œuvre, qui vise à renforcer la structure ou les fondations d’un bâtiment : la moindre malfaçon peut affecter la solidité sur le long terme. La création d’une trémie dans un plancher, la suppression ou le déplacement d’éléments porteurs, ou encore la surélévation d’une maison sont aussi des interventions lourdes sur la structure, donc soumises en principe à la décennale.
Enfin, dès que vous créez une extension, un étage supplémentaire, un garage maçonné ou tout autre volume construit qui s’intègre au bâtiment, vous réalisez un ouvrage au sens juridique. Même si le projet semble « simple », il modifie la structure globale et peut engager la solidité ou la stabilité future. Résultat : ces travaux relèvent en principe de la garantie décennale, car ils constituent un ouvrage au sens de l’article 1792.
4. L’étanchéité et la couverture
Pour vous, la logique est assez directe : dès que vos travaux ont pour fonction de protéger durablement le bâtiment contre les infiltrations, ils sont en principe dans le périmètre décennal, parce qu’un défaut d’étanchéité est typiquement susceptible de rendre l’ouvrage impropre à sa destination. Une défaillance d’étanchéité ne provoque pas seulement une gêne ponctuelle : elle peut rendre l’ouvrage impropre à sa destination, c’est-à-dire inhabitable ou inutilisable normalement, ce qui correspond exactement aux critères de l’article 1792 du Code civil.
C’est le cas de tous les travaux portant sur la toiture et la couverture, qu’il s’agisse d’une pose neuve ou d’une réfection importante. Si la couverture est mal exécutée, l’eau s’infiltre, dégrade les plafonds, les parois et parfois la structure elle-même. La jurisprudence considère de manière constante que des infiltrations durablement liées à une malfaçon de toiture relèvent de la décennale dès lors qu’elles affectent l’habitabilité ou la solidité.
👉 Vous êtes donc dans la décennale dès que vous intervenez sur le clos et le couvert au sens large.
- ● Cela vise la charpente de couverture, évidemment, mais aussi la pose ou le remplacement de tuiles, d’ardoises, de bacs acier, de panneaux de toiture, ainsi que les travaux de zinguerie indispensables à l’évacuation de l’eau, comme les noues, solins, rives, chéneaux ou gouttières intégrées à la couverture. Le point commun est que ces éléments conditionnent l’étanchéité générale : s’ils sont défectueux, le bâtiment n’est plus « hors d’eau ».
- ● La même règle s’applique aux toitures-terrasses, balcons, loggias et ouvrages horizontaux exposés à l’eau. Dès que vous créez ou rénovez une étanchéité de terrasse, par membrane bitumineuse, résine, PVC ou autre procédé, vous réalisez un ouvrage d’étanchéité dont la défaillance peut provoquer des infiltrations massives dans les locaux situés en dessous. C’est typiquement décennal. Ce n’est pas un « confort », c’est une condition d’usage normal. C’est d’ailleurs pour cela que les infiltrations répétées sont l’un des contentieux les plus classiques de décennale, car elles basculent vite dans l’impropriété à destination.
Tous les travaux sur toiture ne sont pas nécessairement décennaux par nature, mais ils le deviennent très vite selon leur ampleur. Une opération d’entretien courant ou une réparation minime et localisée, sans création d’ouvrage et sans impact sur l’étanchéité globale, est en principe hors décennale, sauf si les travaux réalisés créent ou modifient un ouvrage de manière significative.
En revanche, dès que vous réalisez une réfection significative, une reprise complète ou une modification qui engage la fonction d’étanchéité, la décennale s’applique. Les juges raisonnent en fonction du rôle réel des travaux et de leurs conséquences possibles, pas du mot utilisé sur le devis.
5. Les éléments d’équipement indissociables
Au-delà du gros œuvre et de l’étanchéité, vous devez aussi penser aux équipements qui « font corps » avec le bâtiment. Le Code civil étend en effet la garantie décennale à certains éléments d’équipement dès lors qu’ils sont indissociables de l’ouvrage, au sens où vous ne pouvez pas les retirer ou les remplacer sans détériorer la construction elle-même. C’est une notion clé, parce qu’elle fait entrer dans la décennale des travaux qui, à première vue, ressemblent à du second œuvre, mais dont la défaillance peut avoir les mêmes conséquences graves qu’un défaut structurel.
👉 Pour vous, le raisonnement est le suivant : si l’équipement est intégré de manière permanente au bâti au point d’être indissociable, il est traité comme une partie de l’ouvrage ; sa défaillance relève alors de la décennale si elle compromet la solidité ou l’usage normal. Une malfaçon ne créera pas seulement une panne, elle peut rendre le bâtiment inutilisable ou dangereux. C’est précisément ce que vise la décennale. On parle donc d’éléments d’équipement indissociables lorsqu’ils sont encastrés, scellés ou incorporés à la structure, et que leur dépose implique de casser, de déposer un élément porteur, ou d’endommager l’enveloppe du bâtiment.
Vous rencontrez cette situation dans plusieurs familles de travaux:
- ● Les canalisations encastrées dans les murs ou les planchers en sont un exemple évident : une fuite liée à une pose défectueuse peut provoquer des infiltrations généralisées, fragiliser la structure, ou rendre les locaux impropres à l’usage.
- ● Même logique pour une installation électrique noyée dans les parois ou dans une dalle, quand un défaut entraîne un risque grave ou une impossibilité d’usage normal Le plancher chauffant illustre parfaitement la notion d’indissociabilité : puisqu’il est intégré à la dalle, il est impossible à remplacer sans destruction du support ; il relève donc en principe de la décennale si sa défaillance compromet l’usage normal ou la solidité.
- ● L’isolation thermique ou phonique peut aussi être concernée lorsqu’elle est incorporée à l’ouvrage. Si vous posez une isolation intégrée à la toiture, aux murs ou aux planchers, et qu’une malfaçon provoque une perte d’étanchéité, des condensations massives ou une insalubrité rendant le logement inhabitable, vous êtes dans l’impropriété à destination, donc dans la décennale. Ce n’est pas l’isolant en tant que matériau qui compte, mais sa fonction et son mode d’intégration au bâti.
Ce point est particulièrement important pour vous, parce qu’il évite deux erreurs fréquentes. La première serait de croire qu’un équipement relève forcément de la biennale parce qu’il « s’appelle équipement ». La seconde serait de penser qu’un équipement est décennal uniquement s’il touche au gros œuvre. En réalité, ce qui déclenche la décennale, c’est votre incapacité à dissocier l’élément du bâtiment sans l’abîmer, combinée au risque de désordre grave. Une fois que vous gardez cette grille en tête, vous identifiez beaucoup plus vite les chantiers où la décennale est obligatoire.
6. Les travaux de second œuvre
Le second œuvre n’entre pas automatiquement dans la garantie décennale. Contrairement au gros œuvre, il n’est pas décennal « par nature ». Il le devient uniquement si la malfaçon a des conséquences suffisamment graves pour rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou, plus rarement, pour affecter sa solidité. Autrement dit, ce n’est pas l’étiquette « second œuvre » qui compte, mais l’effet réel du désordre sur l’usage normal du bâtiment. C’est exactement ce que retient l’article 1792 du Code civil et ce que la jurisprudence répète de façon constante.
La notion d’« impropriété à destination » est votre boussole ici. Elle signifie que le bâtiment ne peut plus être utilisé comme prévu. Vous pouvez expliquer simplement à vos lecteurs que même un travail considéré comme « intérieur » ou « technique » peut relever de la décennale dès qu’il prive durablement l’ouvrage de sa fonction normale. Ce critère permet d’attraper des désordres qui ne menacent pas forcément la structure, mais qui rendent la vie dedans impossible ou dangereuse.
Prenons des cas parlants :
- ● Une ventilation mal conçue ou mal posée peut paraître secondaire, mais si elle entraîne une humidité chronique, des moisissures généralisées et une insalubrité rendant le logement inhabitable, vous êtes bien dans un désordre décennal. Les juges considèrent alors que l’ouvrage est impropre à sa destination, parce qu’on ne peut plus y vivre normalement.
- ● Même logique pour un carrelage ou un revêtement scellé quand il fait partie d’un système de protection à l’eau. Si sa pose défectueuse provoque des infiltrations récurrentes dans le plancher, dans les cloisons ou chez les voisins, le problème n’est plus esthétique : il touche à l’étanchéité de l’ouvrage et à son usage, donc la décennale peut s’appliquer.
- ● L’isolation, surtout thermique, illustre aussi cette frontière. Une isolation simplement insuffisante relève plutôt de la performance et ne déclenche pas forcément la décennale. En revanche, si une malfaçon d’isolation crée de la condensation massive, des dégâts d’eau internes, des moisissures ou une perte d’habitabilité sur le long terme, vous retombez sur l’impropriété à destination. C’est donc l’ampleur du désordre, et pas le fait que ce soit « de l’isolant », qui déclenche la garantie.
7. Ce qui est exclu
Même si la garantie décennale couvre un périmètre large, elle n’a pas vocation à s’appliquer à tout. En principe, vous êtes hors champ dès que vous êtes sur de l’entretien courant, de la maintenance légère, ou sur un travail dont la fonction est uniquement décorative. L’idée est simple : si, même mal réalisé, le travail ne peut ni fragiliser la structure du bâtiment ni empêcher son usage normal, alors il ne relève pas de la décennale. C’est une limite rappelée régulièrement par les textes et par la jurisprudence.
Vous retrouvez cette exclusion dans tous les travaux d’embellissement pur. La peinture intérieure ou extérieure, les enduits décoratifs, le papier peint, les plinthes, ou encore certains revêtements muraux et de sols simplement posés et facilement démontables sont, par nature, des éléments esthétiques. Tant qu’ils ne participent pas à une fonction essentielle comme l’étanchéité ou l’imperméabilisation, un défaut restera un désordre mineur et ne déclenchera pas la décennale. Les organisations professionnelles le rappellent clairement pour la peinture : lorsqu’elle est seulement décorative, elle n’entre pas dans la décennale.
Vous pouvez aussi ranger dans cette catégorie les petites réparations sans impact structurel. Le remplacement à l’identique d’un élément facilement démontable, une intervention ponctuelle de serrurerie, un changement de robinet, le nettoyage d’une façade ou une reprise localisée d’un revêtement non étanche ne créent pas d’ouvrage et ne modifient pas l’existant de manière lourde. Même si un défaut survient, il ne met pas en cause la solidité ni l’usage général du bâtiment, donc la décennale ne s’applique pas.
👉 Quand vous êtes dans ces cas, les désordres relèvent d’autres garanties. D’abord la garantie de parfait achèvement, qui couvre pendant un an les défauts signalés à la réception ou apparus juste après. Ensuite la garantie biennale de bon fonctionnement, prévue par l’article 1792-3 du Code civil, qui s’applique pendant deux ans aux éléments d’équipement dissociables, c’est-à-dire ceux que vous pouvez enlever ou remplacer sans détériorer le bâti. C’est typiquement le régime des équipements « démontables » ou « remplaçables » comme certains appareils sanitaires, volets, radiateurs, ou accessoires non intégrés à la structure.
8. Les « zones grises » récentes : équipements ajoutés sur existant
Pendant plusieurs années, la Cour de cassation appliquait une logique assez protectrice : même quand un équipement était ajouté sur un bâtiment déjà existant, les désordres qu’il causait pouvaient relever de la décennale dès lors qu’ils rendaient l’ouvrage impropre à sa destination. Cette approche venait d’une jurisprudence de 2017, qui avait élargi le champ d’application de l’article 1792.
Le 21 mars 2024, la troisième chambre civile a opéré un revirement net. Désormais, lorsque vous installez sur un ouvrage existant un élément d’équipement « en remplacement » ou « par adjonction », et que cet élément ne constitue pas en lui-même un ouvrage de construction, il sort du champ de la garantie décennale, même si le désordre est grave et rend le bâtiment impropre à son usage.
La Cour précise aussi que ces désordres ne relèvent pas non plus de la garantie biennale de bon fonctionnement, car celle-ci vise les éléments d’équipement dissociables faisant partie d’un ouvrage. Ils relèvent donc de la responsabilité contractuelle de droit commun. C’est la motivation explicite de l’arrêt 22-18.694 publié au Bulletin.