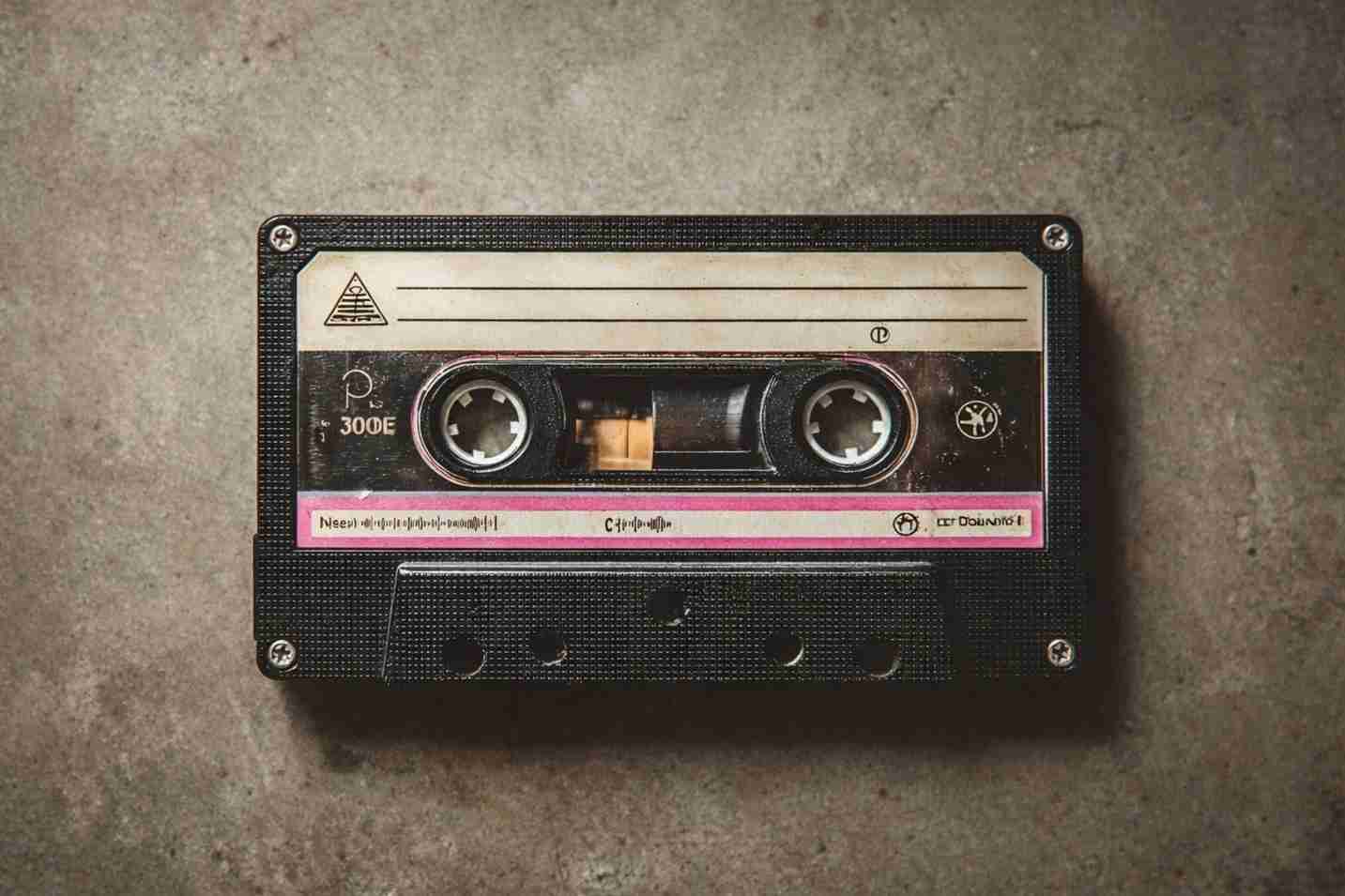1. En résumé
- ➜ Les délais de paiement entre professionnels sont encadrés par l’article L441-10 du Code de commerce : 30 jours par défaut, pouvant aller jusqu’à 60 jours nets ou 45 jours fin de mois selon accord écrit.
- ➜ En cas de retard, des pénalités s’appliquent automatiquement dès le lendemain de l’échéance, calculées au taux de la BCE majoré de 10 points (soit 12,15 % en 2025), plus une indemnité forfaitaire de 40 €.
- ➜ Le recouvrement des factures impayées suit trois étapes : relance amiable, mise en demeure puis, si besoin, injonction de payer devant le tribunal compétent.
- ➜ La prévention des retards repose sur la vérification de la solvabilité des clients, la facturation d’acomptes, des CGV claires et l’automatisation du suivi et des relances..
- ➜ La facturation électronique obligatoire dès 2026-2027 et l’assurance contre les impayés renforcent la sécurité financière et la continuité d’exploitation des entreprises.
.
2. Les délais légaux de paiement entre professionnels
En France, les relations commerciales entre entreprises sont strictement encadrées par l’article L441-10 du Code de commerce. Ce texte, profondément révisé par l’ordonnance du 24 avril 2019 (entrée en vigueur le 1er octobre 2019), a pour objectif de lutter contre les abus de délais de paiement qui fragilisent la trésorerie des petites structures.
Les grandes entreprises, disposant d’une puissance financière plus importante, peuvent être tentées d’imposer à leurs fournisseurs des conditions trop longues. Le législateur a donc fixé des bornes précises, applicables à toutes les transactions entre professionnels établis en France.
Le délai de paiement « de droit commun » : 30 jours
Le principe de base est le suivant : le paiement doit intervenir dans un délai maximal de trente jours après la réception des marchandises ou l’exécution de la prestation de service, sauf disposition contraire expressément convenue entre les parties.
Ce délai « supplétif » s’applique automatiquement si aucune clause contractuelle ne fixe de condition particulière. Il vise à assurer une rotation régulière des flux de trésorerie et à éviter que les fournisseurs ne fassent office de banquiers pour leurs clients.
Les délais convenus par accord contractuel
Les partenaires commerciaux peuvent déroger à ce délai de droit commun à condition que la clause soit formalisée par écrit (dans le contrat, la commande ou les conditions générales de vente) et qu’elle ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du fournisseur. Deux limites s’imposent alors :
- ● Soixante jours nets à compter de la date d’émission de la facture. Ce délai est la borne maximale autorisée dans la majorité des cas. Il se calcule à partir de la date figurant sur la facture, peu importe la date de livraison ou de réception des marchandises, sauf stipulation contraire.
- ● Quarante-cinq jours fin de mois (45 FDM) : ce mode de calcul, admis à titre dérogatoire, est très répandu dans les relations interentreprises. Il permet de simplifier la gestion des échéances, notamment pour les services comptables.
Deux méthodes de calcul reconnues par la DGCCRF
En pratique, deux méthodes de calcul des « 45 jours fin de mois » sont admises à condition qu’elles soient clairement mentionnées dans le contrat et ne dépassent pas la limite légale :
- ● Fin du mois de la facture, puis ajout de 45 jours. Exemple : facture émise le 10 janvier → fin du mois = 31 janvier → échéance au 17 mars.
- ● Date de facture + 45 jours, puis fin du mois. Exemple : facture émise le 10 janvier → +45 jours = 24 février → échéance au 29 février.
L’une ou l’autre méthode est tolérée, tant qu’elle reste clairement mentionnée dans le contrat et ne prolonge pas artificiellement les délais au-delà de la limite légale. Dans tous les cas, la DGCCRF veille à ce qu’aucune entreprise ne détourne cette règle pour retarder indûment ses paiements.
Les dérogations sectorielles
Ces dérogations sont fixées par décret, notamment :
- ● transport routier de marchandises : article L441-11 du Code de commerce et décret n° 2008-1556 du 31 décembre 2008 ;
- ● secteur agroalimentaire : article D441-11 et suivants ;
- ● boissons alcoolisées : article L441-11 I 3° ;
- ● professions réglementées : délais fixés par leurs textes spécifiques.
Ces dérogations sont listées dans des textes d’application publiés au Journal officiel et consultables sur Légifrance.
3. Les pénalités applicables en cas de retard de paiement
Dès qu’une facture arrive à échéance sans être réglée, le client débiteur est automatiquement redevable de pénalités de retard, sans qu’il soit nécessaire d’envoyer une relance ou une mise en demeure préalable. Cette règle est prévue par l’article L441-10, II du Code de commerce : elle s’applique dès le lendemain de la date d’échéance mentionnée sur la facture.
Le taux d’intérêt applicable
Le taux d’intérêt des pénalités est librement fixé par les parties, mais il doit être mentionné dans les conditions générales de vente (CGV) ou sur la facture. À défaut, le taux légal par défaut est celui prévu par le Code de commerce :
Taux des pénalités de retard = taux directeur de la Banque centrale européenne (taux Refi) + 10 points.
Ce taux correspond au taux de refinancement de la BCE en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de l’année concernée, selon la date du contrat ou de la facture. Il évolue deux fois par an, et son niveau est publié au Journal officiel et sur le site de la Banque de France.
Les parties peuvent prévoir dans le contrat un taux supérieur à cette base légale (BCE + 10 points), mais jamais inférieur. Si aucun taux n’est indiqué, la règle du Code de commerce s’applique automatiquement.
Depuis le 11 juin 2025, le taux directeur de la Banque centrale européenne (taux Refi) est fixé à 2,15 %. Le taux minimal légal des pénalités de retard est donc de 12,15 % par an (2,15 % + 10 %). Ce taux évolue à chaque semestre et doit être vérifié sur le site de la Banque de France.
Le calcul des pénalités de retard
Les pénalités se calculent selon la formule suivante :
Montant des pénalités = (montant TTC de la facture × taux annuel / 365) × nombre de jours de retard.
Prenons un exemple concret : une facture de 5 000 € TTC, émise le 1er mars, payable à 30 jours, est réglée avec 30 jours de retard. Si le taux de la BCE est de 2,15 %, le taux de pénalités est donc 12,15 %.
Calcul : 5 000 × (12,15 % / 365) × 30 = 49,93 € de pénalités de retard.
Ce montant est exigible de plein droit, même sans relance formelle, dès le premier jour de retard. Le créancier peut l’ajouter directement sur la facture suivante ou émettre une facture complémentaire spécifique.
L’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
À ces pénalités s’ajoute systématiquement une indemnité forfaitaire de 40 €, prévue par l’article D441-5 du Code de commerce. Elle compense les coûts administratifs supportés par le fournisseur pour effectuer les relances, suivre les paiements et traiter le dossier de recouvrement.
Cette indemnité est fixe et obligatoire : elle est due pour chaque facture payée en retard, quel que soit le montant de la facture ou la durée du retard. Elle s’ajoute automatiquement aux intérêts de retard, et il n’est pas nécessaire de la justifier.
Lorsque les frais de recouvrement réels dépassent ce montant (par exemple, en cas d’intervention d’un cabinet spécialisé ou d’un commissaire de justice), le créancier peut en demander le remboursement complémentaire sur justification.
Les bonnes pratiques à retenir
- ● Mentionne toujours sur tes factures la phrase obligatoire suivante : « En cas de retard de paiement, des pénalités de retard calculées au taux directeur de la BCE majoré de 10 points, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement, seront exigibles de plein droit. »
- ● Vérifie régulièrement le taux Refi en vigueur pour appliquer le bon taux de pénalités.
- ● N’oublie pas que ces pénalités et indemnités ne sont pas accessoires : elles constituent un droit légal du fournisseur et participent à la bonne discipline de paiement entre professionnels.
Exemple récapitulatif
Pour une facture de 5 000 € TTC, payée 30 jours après l’échéance, avec un taux Refi de 2,15 %, les montants dus sont :
- ● Pénalités de retard : 5 000 × (2,15 % + 10 %) / 365 × 30 = ≈ 49,93 € ;
- ● Indemnité forfaitaire : 40 €.
Total dû au titre du retard : 89,93 €.
4. Les recours en cas de non-paiement
Lorsqu’un client professionnel ne règle pas sa facture dans les délais convenus, le fournisseur dispose de plusieurs leviers pour obtenir le paiement. La démarche doit être progressive : commencer par la relance amiable, poursuivre, si nécessaire, par la mise en demeure, et, en dernier recours, engager une procédure judiciaire. Cette gradation permet de préserver la relation commerciale tout en défendant les droits du créancier.
La relance amiable
La première étape consiste à rappeler poliment au client son obligation de paiement. Dans de nombreux cas, le retard résulte d’un simple oubli, d’une erreur administrative ou d’un problème temporaire de trésorerie. Une relance bien formulée suffit alors à débloquer la situation.
La relance peut être effectuée par téléphone, par e-mail ou par courrier. Elle doit rester factuelle :
- ● rappeler la date d’échéance et le montant dû ;
- ● préciser les références de la facture concernée ;
- ● mentionner les pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire de 40 € prévues par les articles L441-10 et D441-5 du Code de commerce ;
- ● proposer un nouveau délai raisonnable de règlement, généralement de 7 à 10 jours.
L’échange doit être professionnel et courtois ; un ton trop ferme dès le premier contact pourrait compromettre la relation commerciale. Il est essentiel de conserver une trace écrite (copie du courriel, compte rendu d’appel, capture d’écran du rappel) pour constituer un dossier complet en cas de suite judiciaire.
La mise en demeure
Si la relance amiable reste sans effet, la seconde étape est l’envoi d’une mise en demeure de payer. Ce document formel est adressé par courrier recommandé avec accusé de réception (ou par voie électronique sécurisée avec preuve de réception). Il a une valeur juridique forte :
- ● il interrompt la prescription ;
- ● il marque le point de départ des intérêts moratoires ;
- ● il démontre la bonne foi du créancier avant toute action en justice.
Le contenu de la mise en demeure doit être précis :
- ● les coordonnées complètes du créancier et du débiteur ;
- ● le montant total dû et la ou les factures concernées ;
- ● la date d’échéance initiale et le calcul des pénalités applicables ;
- ● la base juridique de la demande (articles L441-10 et L441-16 du Code de commerce) ;
- ● un délai ferme pour régulariser la situation (souvent 8 jours) ;
- ● et la mention explicite qu’à défaut de règlement, une procédure judiciaire sera engagée.
Une mise en demeure bien rédigée, datée et signée a souvent un effet dissuasif. Elle montre que le fournisseur maîtrise la procédure et n’hésitera pas à faire valoir ses droits.
Le recouvrement judiciaire
Si, malgré la mise en demeure, la facture reste impayée, le créancier peut saisir la justice pour obtenir le paiement. La procédure la plus simple et la plus fréquente est l’injonction de payer, régie par les articles 1405 à 1425 du Code de procédure civile.
Cette procédure est :
- ● rapide : elle s’effectue sur dossier, sans convocation préalable du débiteur ;
- ● peu coûteuse : les frais de greffe sont modiques et aucune audience n’est requise ;
- ● accessible : la demande peut être déposée en ligne sur la plateforme www.justice.fr.
La juridiction compétente dépend du statut des parties :
- ● le tribunal de commerce pour les litiges entre sociétés commerciales ;
- ● le tribunal judiciaire pour les autres cas (professions libérales, artisans, particuliers exerçant une activité professionnelle).
Le dossier doit comprendre : la copie du contrat ou du bon de commande, les factures, les preuves de livraison ou d’exécution, les échanges de courriels et la mise en demeure restée sans effet.
Si le juge estime la demande fondée, il rend une ordonnance portant injonction de payer. Ce document devient titre exécutoire après signification au débiteur par un commissaire de justice (nouvelle appellation de l’huissier depuis le 1er juillet 2022). Le commissaire de justice pourra ensuite engager des mesures de recouvrement forcé : saisie sur compte bancaire, sur créances ou sur biens mobiliers.
L’importance de la traçabilité
À chaque étape, la traçabilité du dossier est essentielle. Le créancier doit conserver :
- ● les contrats, devis et bons de commande signés ;
- ● les bons de livraison ou attestations de service faits ;
- ● les factures émises et leurs preuves d’envoi ;
- ● les courriers, e-mails et accusés de réception ;
- ● les relances et mises en demeure datées.
Ces éléments serviront de preuves irréfutables en cas de contentieux. Un dossier complet et bien structuré augmente les chances de succès du recouvrement et limite les risques de contestation par le débiteur.
5. Prévenir les retards de paiement
En matière de trésorerie, prévenir vaut mieux que guérir. Une politique de prévention efficace réduit considérablement le risque d’impayés et renforce la stabilité financière de l’entreprise. Ces bonnes pratiques, simples à mettre en œuvre, permettent d’anticiper les difficultés avant qu’elles ne se transforment en contentieux.
Vérifier la solvabilité des nouveaux clients
Avant d’engager une relation commerciale, il est prudent d’évaluer la solidité financière du client. Plusieurs sources permettent de collecter ces informations :
- ● les bilans et comptes de résultats accessibles via Infogreffe ou le registre du commerce ;
- ● les plateformes d’évaluation financière (Altares, Ellisphere, Creditsafe…) ;
- ● les prestataires de renseignement commercial ou les assureurs-crédit, qui attribuent des notations de solvabilité.
Cette vérification préalable, souvent négligée par les TPE, permet d’adapter les conditions de paiement en fonction du profil du client : acompte obligatoire, paiement comptant ou délais réduits.
Facturer un acompte ou des échéances intermédiaires
La facturation échelonnée constitue une méthode efficace pour sécuriser la trésorerie :
- ● Dans les prestations longues, facturer un acompte à la commande (généralement 30 %) limite le risque financier initial.
- ● Pour les contrats étalés dans le temps (bâtiment, maintenance, services informatiques, formation…), prévoir des factures intermédiaires permet d’étaler les encaissements et de suivre le bon déroulement du projet.
Cette pratique, courante dans les marchés publics, améliore la visibilité sur les flux de trésorerie et protège contre les ruptures brutales de paiement.
Les conditions générales de vente (CGV) sont un instrument juridique incontournable. Elles doivent être communiquées avant la conclusion du contrat et comporter des mentions obligatoires :
- ● les délais de paiement applicables ;
- ● les taux de pénalités de retard (au minimum le taux Refi BCE + 10 points) ;
- ● et l’indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement (article D441-5 du Code de commerce).
Des CGV claires et régulièrement mises à jour sécurisent juridiquement les transactions et facilitent les démarches en cas d’impayé. En cas de litige, elles font foi devant le tribunal.
Automatiser les relances et le suivi des factures
Les outils numériques offrent aujourd’hui des solutions puissantes pour gérer le poste client de manière proactive. Les logiciels de facturation modernes (ex. Pennylane, Sellsy, QuickBooks, Axonaut…) permettent de :
- ● programmer des relances automatiques à des intervalles définis ;
- ● suivre l’état de chaque facture (envoyée, consultée, échue, payée) ;
- ● générer automatiquement les pénalités de retard et l’indemnité de 40 € ;
- ● exporter les rapports de suivi pour les experts-comptables.
L’automatisation limite les oublis, accélère les encaissements et libère du temps pour les tâches à plus forte valeur ajoutée.
Passer à la facturation électronique
La facturation électronique deviendra obligatoire pour toutes les entreprises françaises à partir de :
- ● 1er septembre 2026 pour la réception de factures électroniques (toutes entreprises confondues) ;
- ● 1er septembre 2026 pour l’émission par les grandes entreprises et ETI ;
- ● 1er septembre 2027 pour l’émission par les PME et micro-entreprises.
Ces échéances sont confirmées par le décret n° 2024-266 du 25 mars 2024 et les communications officielles de la DGFiP. Ce dispositif, instauré par l’ordonnance n° 2021-1190 du 15 septembre 2021, vise à moderniser la gestion administrative, réduire la fraude à la TVA et accélérer les délais de traitement.
Les factures dématérialisées permettent une traçabilité complète du cycle de paiement, une meilleure détection des retards et une intégration directe dans les logiciels comptables.
Se protéger avec une assurance contre les impayés
Même avec une organisation rigoureuse, le risque zéro n’existe pas. Un client solvable aujourd’hui peut demain être en cessation de paiement, placé en redressement ou liquidation judiciaire. Les conséquences pour le fournisseur peuvent être lourdes : manque de liquidités, difficultés à payer ses propres charges, voire effet domino sur son activité.
Souscrire une assurance contre les impayés constitue donc une mesure de prudence essentielle. Ce type de couverture permet :
- ● de garantir le règlement des créances en cas de défaillance du client ;
- ● d’obtenir des informations de solvabilité en continu sur les clients assurés ;
- ● de bénéficier d’un recouvrement professionnel pris en charge par l’assureur ;
- ● et, le cas échéant, d’une indemnisation partielle ou totale de la facture impayée.
Chez Assurup, nous accompagnons les entrepreneurs, freelances et dirigeants dans la protection complète de leur activité. Nos assurances Responsabilité civile professionnelle (RC Pro) et multirisque professionnelle peuvent inclure des garanties spécifiques contre les pertes financières liées à des impayés ou à la défaillance d’un client majeur.
Ce filet de sécurité permet de maintenir la stabilité de la trésorerie, de préserver la continuité d’exploitation et de sécuriser durablement la croissance de l’entreprise.